The Lastest

How Africa is transforming the fashion industry

Let’s support smart investment in Africa!

Here’s how you can lend your voice to change the world
Our Impact
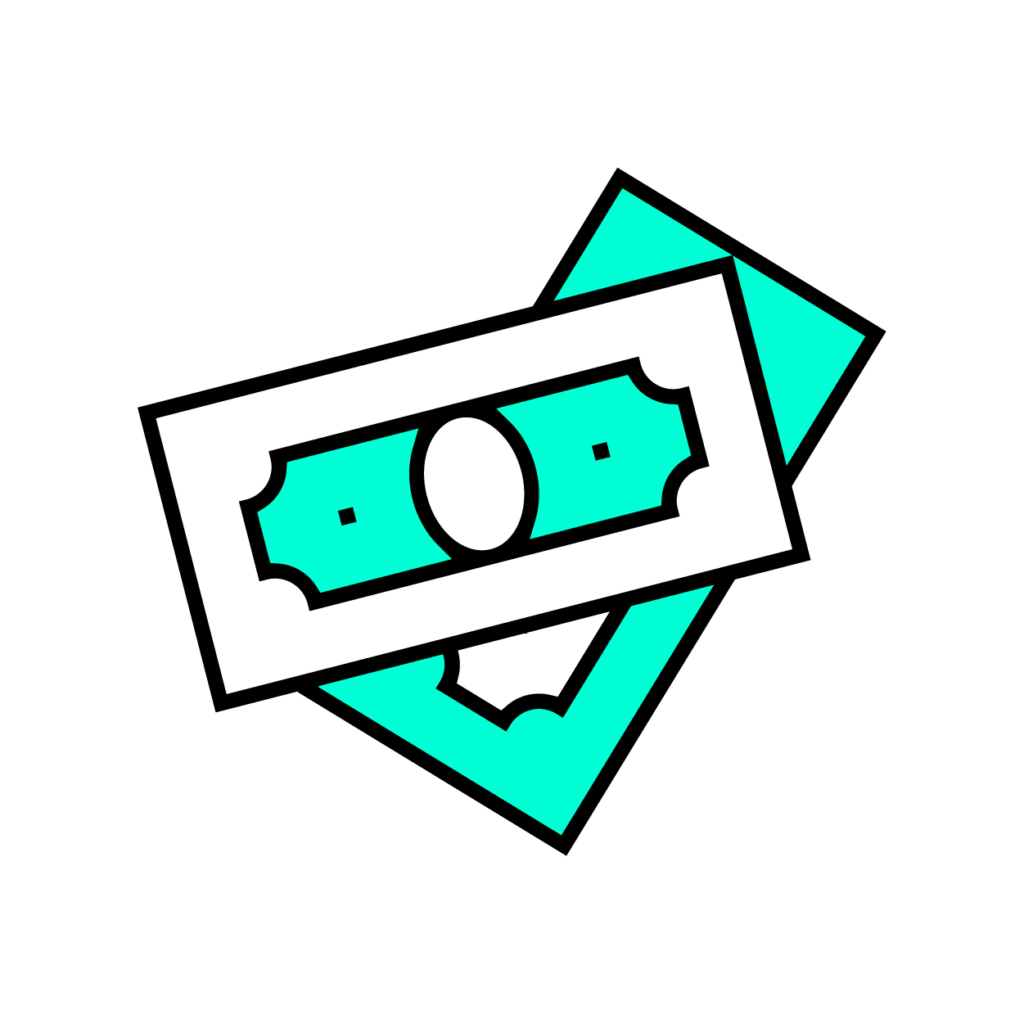
More Funding
We helped secure $72 billion to help more people access healthcare and life-saving tools like vaccines.
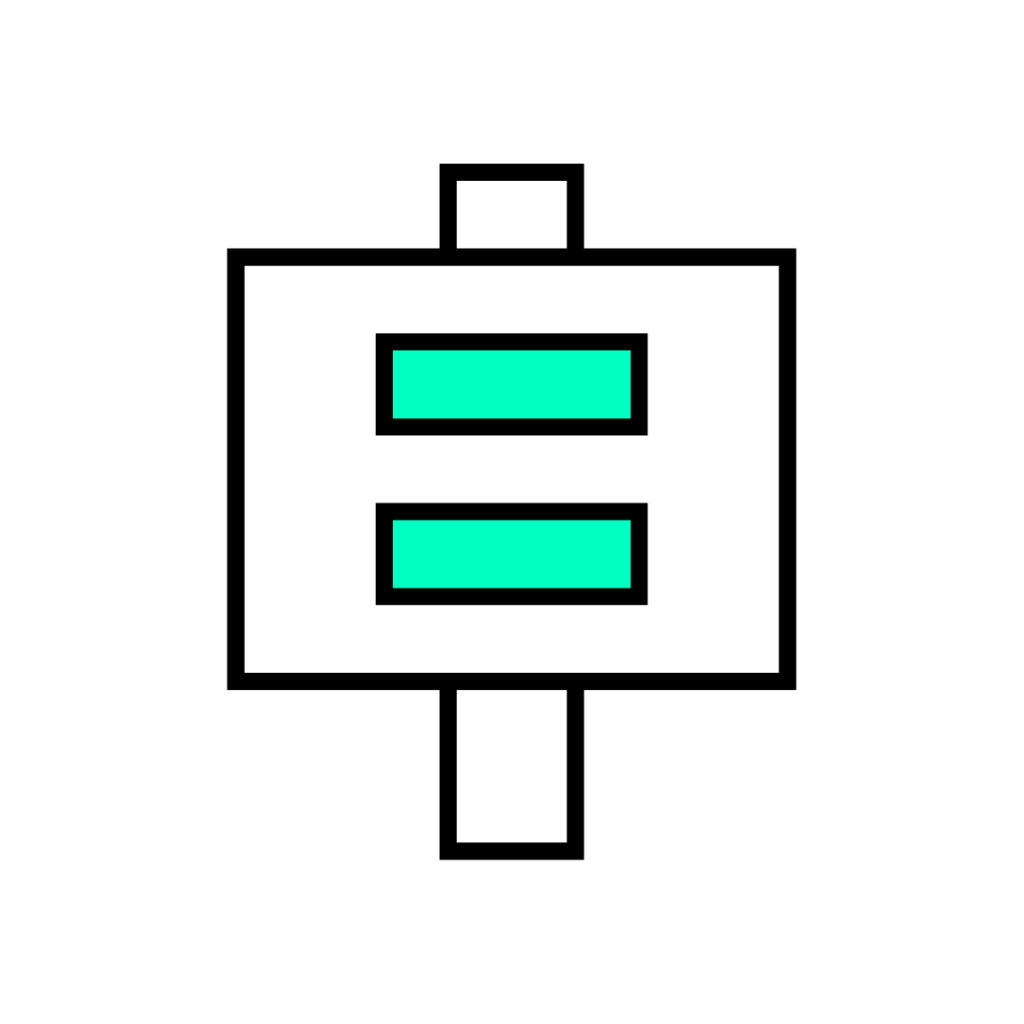
Better Laws
Our activists pushed for stricter gender-based violence laws in Senegal.

Global Cooperation
We brought global activists, leaders, and experts together during COVID-19 to secure $97 billion in pandemic recovery funds.
If you believe everyone has the right to a life of opportunity and justice, no matter where they live, and if you believe ordinary people can change the world, then join us.

